
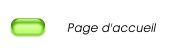
10
000 bénévoles et
45 ans de travail acharné
pour sauver un site d’exception.
pour sauver un site d’exception.
Pour les
groupes de scouts
qui veulent participer à nos chantiers,
contacter Monsieur Marcel Armand au 04 75 54 45 36
ou par e-mail : armand.marcel@orange.fr
contacter Monsieur Marcel Armand au 04 75 54 45 36
ou par e-mail : armand.marcel@orange.fr



Avant restauration.
En cours de restauration.
Aujourd'hui.



Avant restauration.
Aujourd'hui.
les échafaudages font leur apparition.



dégagent les rues et les fondations.
les murs sont triées, stokées.
évacue les remblais.



sont évacués par un petit engin motorisé.
en sens inverse pour monter le sable.
bénévoles travaillant en pleine chaleur.



remblais, les bénévoles remontent les murs.

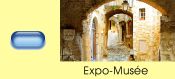



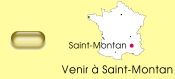

Mairie de Saint-Montan
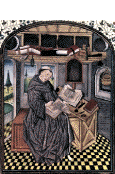

Domaine d'Imbours
Dernière mise à jour : 25 mai 2021
Ce site a été créé par l'association :
Découvrir Saint-Montan et ses environs
E-mail : saintmontan@orange
Paléographie
Héraldique
Généalogie
Ardèche Evasion
Bienvenue en Ardeche
Office de Tourisme de Bourg-Saint-Andéol
Drome Sud Provence
Voyage en Ardèche
Ardèche Tourisme
Les Gorges de l'Ardèche
Restaurants à saintmontan
Domaine d'Imbours
Domaine de La Pacha
Le Palais des Evêques
Location Vacances Ardèche
Ville de Bourg-St-Andéol
Hôtel de Digoine
Ardèche Découverte
Patrimoine Environnement